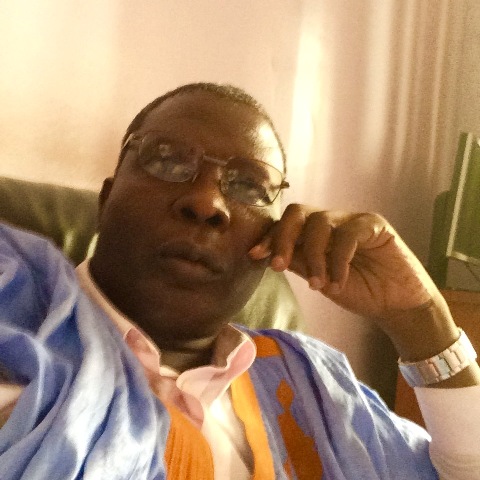
La dissuasion tient à l’idée qu’il ne faut pas passer à l’acte, autrement on ne sait pas qu’est-ce qui peut arriver. Elle devrait être au service de tous. Ceux qui la brandissent comme menace et ceux qui la craignent. Elle nous conforme à une « normalité » qui fait entrevoir à Sun Tzu, le premier des stratèges, au VIᵉ siècle av. J.-C, « la guerre comme l’ultime recours » ; mais, surtout, cette action « inutile et incertaine ».
La question de la dissuasion – ou des dissuasions, si l’on accepte que malgré l’Objet Un, les formes sont multiples – reste posée. Elle le serait d’ailleurs toujours dans un monde où les tensions « en continu » pèsent sur nos têtes comme une épée de Damoclès, le rapport de forces entre puissances militaires traditionnelles et celles « émergentes », au sens économique du terme, étant de plus en plus aléatoires.
Si la crainte de la Guerre Totale, forme achevée des conflits mondiaux du XXème siècle (1914-1918 et 1939-1945) relève aujourd’hui du domaine du hautement improbable, c’est en partie grâce (ou à cause) de notre expérience, à ce jour, de la seule utilisation fatale de l’arme nucléaire contre les villes japonaises, devenues emblématiques, d’Hiroshima et de Nagasaki. Cette « stabilisation » que d’aucuns assimilaient, il y a un demi-siècle, à « l’équilibre de la terreur », ne rassure pourtant plus aujourd’hui.
Les Maîtres du monde (les détenteurs de l’arme nucléaire) qui siègent au Conseil de sécurité (USA, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne) et les pays qui attendent dans l’antichambre de ce Pouvoir « consolidé » (Inde, Pakistan, Israël, Corée du nord) parce qu’ils sont les seuls à avoir bénéficié, à ce jour, du « don » de Prométhée, auront du mal à garantir la pax mundi assurée (promise) par la seule crainte de l’arme nucléaire. Les questions essentielles transcendent la simple peur de l’apocalypse (personne ne se sauvera seul) et touchent à l’essence de l’existence, des Valeurs qui fondent notre humanité (comme la dignité), le religieux et même le culturel.
Ainsi, la notion de puissance et le rôle du militaire ont évolué. Ils déterminent, plus que par le passé, la relation entre le politique et le militaire à travers le prisme de considérations moins rigides, donc difficilement contrôlables.
C’est, justement, ce à quoi fait allusion Jean-Jacques SALOMON : « L’utopie – ou la naïveté – du thème de la fin de l’histoire1 n’a pas résisté au choc de trois facteurs qui ont marqué le passage du XXème au nouveau siècle : le retour des rivalités, des surenchères nationalistes et des massacres ethniques, dont même l’Europe, avec l’explosion de l’ex-Yougoslavie, a été le théâtre ; la montée en puissance des fondamentalismes et du terrorisme mondialisé; le réchauffement du climat et la menace de l’épuisement des ressources non renouvelables. 2»
Alors, face à des menaces non classiques, la dissuasion nucléaire est-elle toujours efficace et pertinente ?
Oui et non. Celle-ci a encore de l’effet contre un pays comme la Corée du nord, dont les « menaces » nucléaires contre Séoul et les USA ne dépassent jamais le seuil des rodomontades. Mais elle est peu efficace contre l’Iran dont la nature du danger est autre. D. Trump le comprend parfaitement quand il brandit l’arme de la dissuasion économique3 pour contraindre Téhéran à renoncer non pas à un programme nucléaire embryonnaire, voire hypothétique, mais à son action subversive en Syrie et au Yémen, ainsi que la menace qu’elle fait peser sur ses voisins du Golfe et sur Israël.
La dissuasion telle que pratiquée au XXème siècle ne peut être adoptée aujourd’hui, elle doit être adaptée. Elle perd de son efficacité dans les « nouveaux conflits » où la prévisibilité s’effectue en avenir incertain. C’est l’un des effets les plus nocifs d’une mondialisation qui a donc « changé et continue à modifier en profondeur les équilibres géopolitiques et la nature même du monde : si l’on scrute l’actualité récente, on verra que de nouveaux acteurs politiques émergent et remettent en question les anciens équilibres. Ce sont (…) des groupes souterrains, par exemple des organisations terroristes 4.» Nous pouvons ici citer le cas de l’Etat Islamique qui, à un certain moment, a aboli la frontière entre l’Irak et la Syrie.
La dissuasion nucléaire est une déraison quand la menace est diffuse. La réponse militaire, classique, est appropriée, pour éradiquer le Mal, comme cela a été le cas contre Al Qaeda de Ben Laden et, plus tard, contre son avatar, l’EI.
Elle l’est moins contre les dictatures. La liquidation de Saddam et la chute de son régime n’ont pas dissuadé Kadhafi de prendre les armes pour « résister » aux nouveaux alliés. Et la mort atroce du Guide n’a pas servi de leçon à Bachar Al-Assad !
Champs de compétition entre Russes et Américains, les nouveaux foyers de tensions en Syrie et en Ukraine rappellent les « chauds » moments de la guerre froide. Ces conflits asymétriques imposent la nécessité de rechercher des dissuasions de même ordre pour ne pas recréer les conditions d’une « guerre froide » hors contexte, pouvant engendrer le désordre.
« Ordre » et désordre
L’intervention de la Russie dans les affaires de l’Ukraine, en 2014, avait des « relents de guerre froide ». Elle constitue, dans le prolongement non déclaré de celle-ci, la réponse aux financements par les États-Unis, depuis 1991, des groupes politiques pro-européens en Ukraine par l'intermédiaire d'ONG comme la Fondation Carnegie. La diplomate américaine Victoria Nuland, représentante du Bureau des affaires européennes et eurasiennes à Washington, avait indiqué que ce financement a dépassé 5 milliards de dollars entre 1991 (date de l'indépendance de l'Ukraine) et 20135.
Certes, il ne s’agit pas du retour au système des blocs « formalisés » par les idéologies capitaliste et socialiste à la fin de la Seconde guerre mondiale, mais bien de la mise en œuvre par la Russie d’une politique de survie. La Bipolarité avec les Etats-Unis ne joue plus comme une « résistance » à une uniformisation malencontreusement vue comme une mondialisation vertueuse. Dans la crise ukrainienne, la Russie défendait son espace vital. C’est elle qui manifeste sa peur de l’autre. Peur de voir se poursuivre cette « émigration » idéologique vers le modèle américain.
En Syrie, par contre, la Russie rend à l’Occident sa monnaie, sa peur. Elle l’effraie même. A l’ordre voulu par les Etats-Unis et leurs alliés européens, elle oppose le désordre. C’est Moscou qui a permis au conflit syrien de se prolonger dans le temps. Ce conflit qui est devenu à la fois guerre civile, guerre énergétique, guerre par procuration et aussi guerre « sainte ». Un conflit qui, de mars 2011 à février 2016, a fait de 260 000 à 470 000 morts d'après les estimations de diverses ONG et de l'ONU.
Il faut craindre que le soutien militaire et politique d’une dictature comme celle de Bachar Al Assad ne fonde la nouvelle stratégie russe : la multiplication des foyers de tension pour pousser les ennemis d’hier, adversaires d’aujourd’hui, à faire des concessions sur plusieurs questions relevant de la sécurité collective. La guerre froide était une adversité qui avait ses règles de chevalerie, ses singularités. Elle passait, quand on atteignait le seuil critique dans une crise, de la confrontation à la concertation. Elle rassurait parce qu’elle était raisonnée. Son propre était l’imprévisibilité des attaques, au sens littéral du terme, et non militaire.
La crainte que suscitent en nous les agissements belliqueux de la Russie vient de ce « tout est permis » qui ne s’arrête plus qu’au seuil du tolérable. Poutine s’autorise à agir en Ukraine et en Syrie comme les USA l’ont fait en Irak et la France en Libye. Finalement, la Russie établie une sorte d’équivalence entre faire chuter un dictateur et maintenir un autre au pouvoir. L’équilibre de la terreur ou destruction mutuelle assurée (DMA, ou MAD en anglais) qu’instaurait – instaure encore – la possession de l’arme nucléaire prend le visage d’une dérégulation progressive des usages en pratique au Conseil de sécurité de l’Onu. Il y a le veto mais il y a également la permission d’agir à sa guise. Une dissuasion par le désordre, l’anarchie.
La Russie utilise une forme nouvelle de dissuasion à laquelle les Américains doivent « faire avec » : ce n’est pas le retour insidieux de la guerre froide mais ce qu’Hélène Carrère d’Encausse appelle la « désorganisation » des Etats pouvant entraîner dans son sillage celle du système de sécurité international. L’impossibilité d’une recomposition de leur empire perdu engendre, chez les Russes, la nécessité d’une stabilisation. Si rien ne se gagne plus, rien ne doit plus se perdre. L’intérêt stratégique chez les Américains aura désormais en face de lui le besoin vital des Russes. C’est de cette logique que découle le soutien « machiavélique de Poutine à Bachar Al-Assad. C’est, dans une logique purement poutinienne, que l’affirmation d’une existence (être par opposition) se confond avec la volonté de puissance.
En cela, la nouvelle force (puissance) de la Russie n’est pas dans ce qu’elle est (militairement) mais dans ce qu’elle fait (stratégiquement).
Car comme le rappelle Michel Godet « si l’histoire ne se répète pas, les comportements humains se reproduisent ». Face aux manifestations de l’hégémonie américaine, la volonté de puissance de la Russie de Poutine réside dans ce mélange de froideur et de zèle dont elle a fait preuve en brouillant les cartes de la communauté internationale en Ukraine et en Syrie.
SNEIBA Mohamed
---------------------------------------------
NOTES :
- La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, Francis Fukuyama.
- Une civilisation à hauts risques, Jean-Jacques Salomon, éd. Charles Léopold Mayer, p. 10.
- Sur son compte Twitter, le président américain a posté - sans autre commentaire - une affiche le montrant en train de marcher, costume bleu nuit et cravate rouge, la tête dirigée sur le côté, avec la mention "Les sanctions viennent" ("Sanctions are coming" en anglais) en référence à "Winter is coming", titre du premier épisode de la série blockbuster. L'affiche précise que ces sanctions arriveront le 5 novembre. Autre référence à "GoT", les "O" sont barrés de trois bandes verticales. (lefigaro.fr)
- Mooc : La francophonie, essence culturelle, nécessité politique, 2018.
- Ukraine : le grossier aveu de Victoria Nuland, https://fr.sputniknews.com











